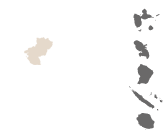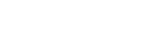Infos locales
Blain - La chapelle Saint-Roch, un trésor sur son rocher
Érigée en l’an 1450, pour conjurer une épidémie de peste noire, la chapelle Saint-Roch est le témoin de l’histoire de la commune. Aujourd’hui, le lieu peut se visiter.
Elle a, pourtant, survécu à une potentielle destruction, prévue dans les années 1990. « Quand nous avons pris possession des lieux, elle était enfouie dans un roncier inextricable, qui ne permettait même pas d’y entrer. La toiture était dans un état de délabrement », situe Jacky Flippot, alors président de château essor Blinois et l’un des instigateurs du Centre de la fresque. « Propriété de la commune, qui l’a rachetée à l’agriculteur du village de Saint-Roch, la chapelle a été mise à notre disposition, pour en faire le premier chantier expérimental d’art A fresco, dans l’Ouest. »
Alors que la commune réparait la toiture, les compagnons de Saint-Roch entreprenaient, sous la conduite de Louis Roger, artiste peintre et graveur, la réalisation sur les murs intérieurs de la chapelle, d’une fresque monumentale de plus de 100 m2.
De nouveaux vitraux, sobres et modernes, posés tout dernièrement par Michel Pechousek, vitrier d’art, mettent encore un peu plus en valeur, ces fresques colorées. Six siècles après sa construction, la chapelle Saint-Roch retrouve ainsi de la vitalité.
Aujourd’hui, la chapelle peut se découvrir en parcourant à pied ou à vélo, le circuit des sites : un parcours facile de 8,8 km, à partir du port de Blain.
Source : Ouest-France, 25/07/2023
Pornic - L’été à Pornic vu... par les Pornicais
Pornic accueille, chaque été, des dizaines de milliers de visiteurs. Les Pornicais profitent eux aussi de l’effervescence dans la ville, malgré ses désagréments.
Commerçants, promeneurs ou retraités profitent des rues animées par les touristes curieux. Mme Chauvin, 89 ans, apprécie de faire sa marche quotidienne dans les rues de la ville. « À mon âge, je ne prends plus le chemin côtier, mais je me promène sur la Ria ou sur les quais », raconte-t-elle.
« Quand on vieillit c’est plus difficile. Et aujourd’hui, je trouve qu’il y a un peu trop de monde et trop d’habitations. »
Parmi les principales difficultés que pointent les Pornicais, le manque de places de parking revient le plus souvent. « C’est vraiment difficile de trouver une place où se garer, explique Nawel Djebbari, étudiante l’année et saisonnière à Pornic, où elle a grandi. Parmi mes collègues, plusieurs ont déjà pris des amendes, dernièrement, à cause du manque de places. »
« Le château, c’est un peu notre tour Eiffel, donc le port attire beaucoup de monde, explique Roxane Baumal, directrice de l’office de tourisme de Pornic. Cette sensation de pic de fréquentation vient du fait que la majorité des passants sont des excursionnistes, ils sont sur place au minimum deux heures mais n’y dorment pas. Et la grande majorité vient des Pays de la Loire. »
« Pour moi c’est top, car plus il y a de monde, mieux c’est », estime Brigitte Lambourg, artiste peintre et pornicaise depuis deux ans. Elle tient son atelier ouvert dans la ville haute, rue de l’Église. « Il y a une super ambiance de village, on s’entend tous très bien, même avec le curé plus haut ! », sourit-elle.
Mais elle souhaiterait que les visiteurs découvrent mieux la ville. « La ville haute mériterait d’être mieux connue, il y a moins de touristes, alors qu’il y a une vraie richesse patrimoniale. »
Même si l’afflux de vacanciers est une épreuve pour certains, les habitants restent attachés à leur ville. « Rien ne vaut Pornic, assure Mme Chauvin. En Bretagne, on est très privilégié avec le climat très doux et, à Pornic, on se sent breton ! »
Source : Ouest-France, 24/07/2023
Loire-Atlantique - La nature se découvre à vélo, au bord du Brivet
En partenariat avec Loire-Atlantique développement, prenez un bol d’air frais au bord du Brivet et partez à la découverte d’une biodiversité exceptionnelle, le long de la boucle vélo la Petite reine brivetaine qui nous plonge dans la Vallée du Brivet à la découverte de sa faune et de sa flore si riche. On y observe les oiseaux, les traces laissées par les loutres et les nombreux chevaux qui pâturent au bord du chemin.
De Pontchâteau à Drefféac, il est possible de faire un détour par les jolies landes de Bilais. Sauvages et préservées, ces espaces naturels sont classés espaces naturels sensibles, en raison de la grande diversité de leur faune et de leur flore. Tout au long du trajet, le petit patrimoine témoigne de l’histoire et des modes de vie des habitants. À Branducas, un arrêt s’impose devant le four du village. Autrefois, chaque famille avait son jour de boulange. Après Drefféac, l’itinéraire traverse les cours d’eau et les canaux qui alimentent le marais, et commence à longer l’autre rive du Brivet, direction Sainte-Anne-sur-Brivet. On retrouve très vite la quiétude des espaces naturels, de la rivière qui s’écoule paisiblement et des animaux qui vivent en ces lieux.
Ici, il faut savoir prendre le temps d’observer la nature, pour avoir la chance d’apercevoir les habitants du marais. Ragondins, oiseaux, batraciens, papillons et insectes peuplent les lieux, sans oublier les vaches et les chevaux qui profitent de la bonne herbe bien grasse de ces espaces verdoyants.
Le marais, ses cours d’eau et ses douves sont aussi l’habitat d’un animal invisible : la loutre qui est très discrète, d’autant qu’elle vit la nuit, mais on peut repérer sa trace par ses épreintes.
À voir, à faire :
Visiter le Vallon des butineurs situé à Pontchâteau. C’est un parc dédié à la découverte des pollinisateurs et de leur rôle dans la production alimentaire et la préservation de la biodiversité.
Louer un canoë, un kayak ou un paddle pour partir à la découverte du Brivet. La location se fait au chalet de l’Office de Tourisme, allée du Brivet, à Pontchâteau. À la demi-journée ou pour une ou deux heures, découvrez le Brivet autrement.
Distance : 23 kilomètres.
Source : Ouest-France, 23/07/2023
Saint-Nazaire - Le Petit-Maroc, l’île originelle de la ville
Série d’été : les îles d’ici. Hôte du festival Les Escales, le petit quartier de Saint-Nazaire vit au rythme des bateaux entrant et sortant du port.
Soudain, un coup de sifflet. Sous les regards impressionnés des passants, le pont levant qui relie le berceau de Saint-Nazaire au centre-ville se redresse pour laisser passer un remorqueur. C’est sans doute dans les années 1930 qu’il trouve son nom lié aux pêcheurs bretons qui naviguaient parfois vers le Maroc. Il fait partie intégrante de la cité navale, mais est seulement relié au continent par les ponts tournant et levant de l’écluse sud, ainsi que le petit ouvrage d’art de l’entrée est.
Événement photogénique pour les touristes, le mouvement de ces ponts apparaît néanmoins fréquemment dans les journaux. ? « Quand les ponts sont hors service, ça m’arrive d’emmener des enfants à l’école avec ma voiture par Penhoët », témoigne Catherine Roux.
Ces ouvrages, parfois anciens (le pont tournant de l’écluse sud date de 1907), nécessitent une maintenance permanente. Et ils ne sont pas épargnés par les accidents : un cargo qui avait heurté le pont levant en juillet 2020, se retrouvant par malchance avec les deux principaux accès immobilisés pendant cinq mois.
« C’est un quartier bohème, artistique », juge Catherine Roux. La décennie 1990 a vu Saint-Nazaire se tourner progressivement vers son port, théâtre de l’installation lumineuse de Yann Kersalé La nuit des docks en 1991, mais aussi du festival Les Escales depuis 1992.
Ludovic Roquet, patron du bistrot du Grand Pavois depuis cinq ans, voit un quartier dont « l’identité est en pleine mutation ». Derrière la pêche et les arts, les projets immobiliers de la Ville et du Port (qui se partagent ce territoire) font parfois grincer des dents. Le projet de tour à douze étages, qui servirait à loger les étudiants des Beaux-Arts, ferait disparaître les fresques visibles sur la place de la Rampe, auxquelles de nombreux habitants tiennent.
En attendant, chacun peut toujours venir admirer Exodus 2, la deuxième partie d’un diptyque du chilien Inti montrant un réfugié subsaharien. La première est visible à Rabat au (grand) Maroc.
Source : Presse Océan, 23/07/2023
Batz-sur-Mer - Du canyoning sensible à la biodiversité côtière
L’office de tourisme de Batz-sur-Mer a lancé, à la mi-juillet, un site de canyoning en mer, où y sont alliées sensations et sensibilisation à la question environnementale.
« C’était vraiment important pour moi de mettre en place une telle activité, dans un tel lieu, avec une telle diversité. » Maxime Chatellier, 38 ans, a eu l’idée de créer un parcours de canyoning sur la baie du Cardonnet, à Batz-sur-Mer, il y a un peu plus d’un an. « J’ai développé le projet en 2015, d’abord au Croisic, sur le site d’escalade, mais il a été refusé par les élus. J’ai donc mis le projet en stand-by. Mais à mon retour de la Réunion, j’ai pas mal réfléchi et j’ai proposé le projet à Batz-sur-Mer, qui a été accepté. »
Après une série de repérages, celui qui est aussi moniteur d’escalade à El Cap, à Saint-Herblain, a finalement jeté son dévolu sur cette façade où d’imposants blocs de roches se jettent à l’eau, permettant de faire des sauts de plus de douze mètres à marée basse. Mais avant de se lancer, Maxime Chatellier a dû passer par la DDTM (Direction départementale des territoires de la mer) car le site n’est pas comme les autres.
Car en plus d’être une pratique très rare en France, ce spot de canyoning de mer est très particulier. Implanté sur un site protégé, qui a hérité du label Natura 2000, son accès est normalement interdit au public, à moins de disposer d’une autorisation préfectorale, ce qui n’empêche pas des jeunes en recherche de sensation de s’aventurer dans les rochers. « Il a une biodiversité vraiment particulière, avec certaines espèces d’oiseaux et de plantes qu’il faut protéger. Et en faisant ce parcours de canyoning, je cherche à avertir sur les raisons pour lesquelles il faut protéger ce site. »
Car l’objectif de Maxime, originaire de Clisson, mais qui a passé « les vingt dernières années de sa vie à grimper au Croisic », est avant tout de faire découvrir cette côte sauvage, non pas d’en faire « une machine à sous et développer des projets partout sur la côte. C’est pourquoi on ne cherchera pas beaucoup à faire évoluer le site ». Seules les possibilités de sessions de nuit ou d’un parcours enfant sont envisagées pour la saison prochaine.
Un parcours à la fois sportif et familial
Au final, plusieurs sauts peuvent être réalisés tout au long du parcours, qui s’étend sur les différents îlots rocheux, accompagné par de l’escalade, des descentes en rappel et même de la tyrolienne. « Le parcours reste accessible à tous, par tous les temps, par toutes les marées, et peut être adapté en fonction du niveau de nage de chaque participant », d’après Maxime Chatellier.
Source : Ouest-France, 22/07/2023
Nort-sur-Erdre - « Le canal de Nantes à Brest est un havre de paix »
La vie au bord du canal. Cet été, Ouest-France vous transporte sur les berges du canal de Nantes à Brest. Et même si la navigation est impossible en partie, du fait des travaux au barrage de Vioreau.
Au bord de l’écluse de la Rabinière, à Nort-sur-Erdre, un bâtiment a les pieds dans l’eau. C’est le centre d’intervention. Il loge l’unité voies navigables et milieux naturels, un service départemental, en charge de la section ligérienne du canal de Nantes à Brest.
En Loire-Atlantique, le canal s’étend sur 95 km de Nantes à Saint-Nicolas-de-Redon. Puis, il file à travers dix-huit écluses et quinze communes. Il permet à ceux qui voguent sur son lit de rallier la Vilaine depuis l’Erdre.
Sauf cet été, les écluses sont fermées. Le barrage de Vioreau étant en travaux, son lac est asséché. Ce qui n’est pas sans impact pour la partie est du canal, alimentée en eau par le réservoir. De Nort à Guenrouët, la navigation est impossible. C’est seulement à partir de Fégréac que les plaisanciers peuvent circuler.
Il n’y a pas que les 1 700 plaisanciers de passage chaque année qui le font vivre. Chaque saison, le canal voit passer sur ses berges 28 000 piétons et plus de 20 000 cyclistes, qui pédalent sur les anciens chemins de halage transformés en Vélodyssée.
« L’objectif du Département est d’améliorer le confort des touristes », commente Peter Dugué, dont le poste a été conçu pour répondre à cette tâche. Dans le viseur, entre autres, le développement du slow tourisme, conciliable avec les enjeux environnementaux.
Le service unité voies navigables et milieux naturels a aussi pour mission de réhabiliter les maisons éclusières, qui font le charme du canal. Ou encore les sites très fréquentés comme Bout-de-Bois à Saffré, le musée la Maison du canal à Fégréac, le port de Blain, etc.
Du naturel dans l’artificiel
« De l’écluse de Quiheix à celle du Gué-de-l’Atelier, à Héric, le canal est très artificiel. Après, les paysages sont très différents, car l’Isac reprend son cours, c’est plus naturel.
Et quid des effets du dérèglement climatique sur le canal ? « Dans les années 1990, les éclusiers géraient une crue sur quatre, cinq jours. Ces épisodes étaient plus réguliers. Aujourd’hui, elles sont plus brèves et en deux jours, c’est bâclé. Pour certains, cela ne veut rien dire. Mais moi, mon sentiment d’éclusier, c’est qu’il y a quand même moins d’eau l’hiver, confie Adrien Aliau l’éclusier.
Au fil de l’eau, le canal n’est plus seulement un outil de navigation. « Aujourd’hui, on le considère aussi comme un havre de paix pour les humains, la faune et la flore. Malgré les sécheresses, il y a toujours de l’eau dans le canal.
Source : Ouest-France, 22/07/2023
La Chevrolière - nature. 13 idées de balades pour découvrir la commune
Valérie Grandjouan, conseillère municipale déléguée à la randonnée, et Aymeric Perocheau, conseiller municipal, proposent 13 idées de balades dans la commune.
Quelle est la démarche ?
Valérie Grandjouan :
"La Chevrolière ambitionne de requalifier ses espaces publics pour faciliter les mobilités douces, c'est-à-dire à pied ou à vélo, tout en invitant à la découverte de ses paysages. Conscients de la diversité et de la richesse des paysages, les élus ont souhaité étudier toutes les idées de promenade sur la commune de 3 256 ha à partir des routes ou des chemins communaux. Elles viennent étoffer les sept sentiers du patrimoine édités au début de l'été par le Conseil des sages pour valoriser le patrimoine naturel local. Ces circuits pourront être complétés à l'avenir."
A qui s'adressent les circuits ?
Valérie Grandjouan :
"Au randonneur averti comme au promeneur flâneur. Les boucles de 4 à 6 km représentent de 1 heure à 2 heures de marche. Certains parcours sont praticables pour les poussettes ou les trottinettes.
Avec des variantes, ils prennent leur départ dans les villages autour de la commune. Les 13 idées de balades sont téléchargeables sur le site internet de la ville.
Qu'est-ce qui est à voir à La Chevrolière ?
Aymeric Perocheau :
"Des sites remarquables naturels ou patrimoniaux. Sur la commune, nous avons des arbres magnifiques et des voûtes cathédrales végétales. Ces idées de balades permettent également de découvrir des constructions atypiques comme des chapelles ou des puits, des bâtiments caractéristiques de l'architecture locale tels que la Maison des pêcheurs à Passay.
Source : Le Courrier du Pays de Retz, 21/07/2023
Savenay - Découverte à vélo de la faune et de la flore locale
8 km de balade à vélo, au cœur des roselières des marais ligériens, séparent le pôle de loisirs du lac de Savenay et Lavau-sur-Loire.
Une guide conférencière de l’office de tourisme Estuaire et Sillon accompagne les curieux, pour une visite guidée et commentée, autour de ce milieu préservé où coexistent une faune et une flore remarquablement riches.
Cette promenade permettra de découvrir l’histoire et l’aménagement du marais, ainsi que tous les enjeux de son exploitation actuelle (la gestion de l’eau, l’agriculture, son entretien, etc.). Le long de la balade des roselières, deux nids observatoires, offrant une vue imprenable sur les marais de la Loire et inspirés de ceux des cigognes voisines, permettront l’observation de quelques-unes des espèces endémiques des marais, tel que le héron cendré ou l’aigrette garzette.
Ce vendredi et vendredi 4 août, balade des roselières, départ à 9 h 30, Inscriptions à l’office de tourisme Estuaire et Sillon.
Source : Ouest-France, 19/07/2023